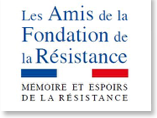Dewavrin André "Passy"
Auteur de la fiche : Jacques Isnard et Guillaume Piketty
André Dewavrin
|
JACQUES ISNARD Publié le 22 décembre 1998 ANDRÉ DEWAVRIN, alias colonel Passy, chef des services spéciaux gaullistes, à Londres, puis à Alger, pendant la seconde guerre mondiale, compagnon de la Libération, est mort à Paris dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 décembre. Il était dans sa quatre-vingt-huitième année. Né le 9 juin 1911 à Paris, André Dewavrin, polytechnicien, enseigne, à vingt-sept ans, comme capitaine du génie, la fortification à Saint-Cyr quand la guerre survient. Il participe alors à la campagne de Norvège, sous les ordres du général Béthouart, face à l’invasion allemande en 1940. Mais, dès juillet 1940, voilà ce petit homme « au visage naïf d’un grand bébé blond » – comme aime à le décrire Jean-Louis Crémieux-Brilhac, un autre grand résistant -, parmi les plus proches collaborateurs, encore bien peu nombreux, du général de Gaulle, à son QG de Saint Stephen’s House, à Londres, aux côtés de René Cassin ou du vice-amiral Emile Muselier. D’allure très réservée, presque froid, pédagogue – il en irritera plus d’un par cet esprit clair et volontiers didactique -, mais aussi assez autoritaire, André Dewavrin va se voir confier, à vingt-neuf ans, les 2e et 3e bureaux d’un état- major gaulliste encore fort embryonnaire. Il va dès lors mettre sur pied, et diriger pendant presque quatre ans, une des réussites les plus impressionnantes de l’aventure du général de Gaulle en terre britannique, à savoir des services militaires de renseignement et d’action, à la responsabilité desquels il n’avait été prédestiné en rien. Sous le pseudonyme de « Passy », et avec le titre de chargé de mission de 1re classe du commissariat à l’intérieur (l’équivalent du grade de lieutenant-colonel), André Dewavrin va monter de toutes pièces, avec l’industriel André Manuel, le service de renseignement de la France libre qui – fort de ses soixante hommes, au départ, pour en compter trois cent cinquante à la fin de la guerre – devait devenir le bureau central de renseignement et d’action (BCRA), puis, en novembre 1943, la direction générale des services secrets (DGSS), quand Jacques Soustelle, sur requête du général de Gaulle, devra regrouper les activités du renseignement. A son poste, le colonel Passy se révèle solide, souvent lucide, doué du sens de l’organisation, mais vindicatif à l’encontre de ceux dont il juge qu’ils lui ont manqué. Il se débat entre les intrigues et les querelles. D’abord, les intrigues ou les machinations fomentées par des services secrets britanniques rivaux. A Londres, mais sur le terrain aussi, le MI6 s’oppose au Special Operation Executive (SOE) : Passy parvient à garder tant bien que mal les contacts avec le MI6 et il aura des relations plus que difficiles avec le SOE, qui a créé une section purement britannique d’action subversive en France (la section F du lieutenant-colonel Maurice Buckmaster) et qui n’hésite pas à entrer en contact avec les clandestins anti-gaullistes. Face à la répression allemande qui démantèle les réseaux en France, André Dewavrin a besoin de l’aide de ces services britanniques pour des parachutages, des opérations aériennes, des transmissions et jusqu’à un code chiffré. On la lui procurera, plutôt au compte-gouttes. Ensuite, les querelles au sein de l’entourage du général de Gaulle. A Londres, et cela continuera à Alger, le colonel Passy ne se fait pas que des amis. Il est accusé – une légende qu’il juge « calomnieuse » et qui persistera après la guerre – de venir de l’extrême droite française et d’appartenir à la Cagoule, le surnom donné à un groupe partisan de l’action violente pour abattre la République en 1935. Et puis, il y a ces inimitiés, inévitables en période de crise aussi intense, qui naissent et qui enflent. Telle celle avec Emmanuel d’Astier de La Vigerie, qui fonde son propre mouvement en 1943 et qu’André Dewavrin soupçonnera de jouer le jeu britannique. Passy écrira dans ses mémoires que « cet anarchiste en escarpins » était « un mélange de condottiere et de Machiavel ». COMPAGNON DE LA LIBÉRATION C’est en septembre 1941 que le BCRA commence à nouer des liens réguliers avec la Résistance intérieure et c’est le mois suivant que Passy fera la connaissance de Jean Moulin, le futur « unificateur » des mouvements de la Résistance sous le nom de code de « Max », avec lequel il apprendra à sauter en parachute et qu’il présentera au chef de la France libre. Mais c’est peu après, en 1942, alors que Jean Moulin a été parachuté en France pour la mission que lui a confiée de Gaulle, qu’André Dewavrin va unir ses efforts dans l’action clandestine à ceux de Pierre Brossolette, son second à la tête du BCRA, qui devient un Etat dans l’Etat gaulliste et un enjeu dans la lutte de pouvoir attendue pour après la libération de la France. Passy choisira de soutenir Brossolette, qui s’oppose souvent à « Max », entre autres, sur la question de savoir s’il faut en appeler, ou non, aux anciens dirigeants des partis politiques, déconsidérés, de la IIIe République. Durant six semaines, entre février et avril 1943, Passy (« Arquebuse ») et Brossolette (« Brumaire ») vont faire, en zone nord, un premier recensement systématique des moyens de la Résistance et de la France combattante pour aboutir à proposer une ébauche de leur réorganisation. Mis devant le fait accompli, « Max » s’en formalisera. Le 20 mai 1943, Passy est fait compagnon de la Libération, au titre de lieutenant-colonel du BCRA. Il a alors quitté Londres pour Alger, avec le général de Gaulle. Durant l’été, avant qu’il ne soit absorbé – de fait, renforcé et confirmé – par la création de la DGSS, le BCRA tentera de prévoir la mise en place, en France, de nouvelles structures militaires, s’attirant, selon Passy, « les foudres et les rancunes innombrables et tenaces » de ses contestataires qui lui reprochent de vouloir freiner le passage de la Résistance à l’action armée. Ce travail sera néanmoins à l’origine de la constitution de groupes intégrés aux Forces françaises de l’intérieur (FFI) commandées par le général Koenig. Parachuté le 5 août 1944 dans la région de Guingamp pour assister la résistance bretonne, le colonel Passy, à la tête de 2 500 FFI associés à des éléments américains, contribue à la libération de Paimpol, où il y aura 2 000 prisonniers. En 1945, Passy devient directeur général de la direction générale des études et recherches (DGER), l’ancêtre du Sdece, puis de l’actuelle DGSE. Il quitte ce poste en 1946, après le départ du général de Gaulle, alors qu’éclate une affaire confuse de répartition, mal contrôlée, des fonds secrets. Ce qui lui vaut, sur l’instant, une peine d’arrêt de forteresse à Vincennes et, plus tard, d’être « lavé », comme il l’écrira dans Le Monde du 17 février 1966, d’une « infamie » répandue sur son compte. André Dewavrin exerce ensuite des responsabilités à la tête de plusieurs sociétés jusqu’à la fin des années 70. Il a écrit une série d’ouvrages, dont quatre tomes successifs sur ses missions secrètes. En mai 1981, il appelle à élire François Mitterrand, contre Valéry Giscard d’Estaing. Titulaire de la croix de guerre 1939-1945, de la médaille de la Résistance et de décorations étrangères (britannique, polonaise et norvégienne), André Dewavrin était grand-croix de la Légion d’honneur. ——————— Guillaume Piketty Après avoir publié les mémoires de Raymond Aubrac (Où la mémoire s’attarde, 1996), une biographie de Pierre Brossolette (Guillaume Piketty, Pierre Brossolette, Un héros de la Résistance, 1998) ainsi qu’une anthologie des plus grands textes écrits par celui-ci (Pierre Brossolette, Résistance (1927-1943), 1998, textes rassemblés et présentés par G. Piketty), puis les souvenirs de Maurice Kriegel-Valrimont (Mémoires rebelles, 1999), les éditions Odile Jacob viennent de rééditer les mémoires du colonel Passy, le fondateur des services secrets de la France libre, présentés et annotés par Jean-Louis Crémieux-Brilhac. Accès est ainsi rendu au témoignage d’un des plus importants acteurs de l’aventure gaullienne des années sombres. Né le 9 juin 1911, engagé dans l’armée en 1933 à sa sortie de l’École Polytechnique, le capitaine André Dewavrin parvint à Londres en juin 1940 avec les restes du corps expéditionnaire français en Norvège. Le 1er juillet, le général De Gaulle l’investit d’une tâche écrasante, et dont ce professeur de fortification à Saint-Cyr ignorait tout : créer et animer les 2è et 3è bureaux de son état-major. Rien de moins… En quatre années, comme le rappelle Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Passy monta « une machinerie des services secrets sans exemple dans notre histoire » et fit du Bureau central de renseignement et d’action (BCRA) « une grande maison. Renseignements militaires puis politiques, sabotages, évasions, transmissions, actions de guerre, préparation du « soulèvement national » : de lui et de ses équipes ont dépendu toutes les relations entre la France libre et la Résistance intérieure française« . Au long des années sombres, en dépit de toutes les vicissitudes, par-delà les succès et les échecs, les joies et les drames, Charles De Gaulle ne cessa de confirmer sa confiance au colonel Passy et le maintint en place, selon ses propres termes, « à travers vents et marées ». Initialement publiés en trois tomes successifs, entre 1947 et 1951 (Souvenirs du 2è Bureau, Londres (1940-1941); 10 Duke Street : le BCRA (1942); Missions secrètes en France (novembre 1942-juin 1943), ces mémoires ont été réunis pour l’occasion en un seul volume. Elles sont précédées d’une très utile préface. A la fois acteur et historien des années sombres, auteur, entre autres, d’une remarquable France libre (la France libre, De l’appel du 18 juin à la Libération, Gallimard, 1996). Jean-Louis Crémieux-Brilhac donne les clefs indispensables à la lecture d’un ouvrage complexe. Fondés sur l’ample documentation que Passy avait fait constituer en 1945-46 en un Livre blanc du BCRA aujourd’hui encore inédit, ces souvenirs racontent en effet l’histoire des services secrets de la France libre puis combattante de juillet 1940 à juillet 1943. Ils montrent l’improvisation des tout premiers mois de la France libre, la constitution hautement aléatoire d’un embryon de service de renseignements, l’apprentissage de la guerre secrète auprès de l’allié anglais dont il fallait tout à la fois s’inspirer et se garder. Ils évoquent le difficile établissement des liaisons avec la France occupée ou soumise au régime de Vichy, les tâtonnements des premiers réseaux de renseignements, les relations progressivement établies avec les organisations de la Résistance intérieure française. Ils décrivent le « kaléidoscope londonien« , les rivalités internes à la France libre puis combattante, en particulier celle qui ne cessa de mettre aux prises le Commissariat national à l’Intérieur (CNI) et le BCRA pour la primauté de la conception puis de l’action politique en France. La question de la prise en compte des partis politiques dans les instances dirigeantes de la Résistance intérieure et, partant, à Londres puis à Alger, est également abordée à la lumière des événements de l’automne 1942, en Afrique du Nord notamment. Surtout, l’ouvrage s’achève sur le récit détaillé de la mission Arquebuse-Brumaire puis de la constitution du Conseil national de la Résistance (CNR). Au cours de l’hiver 1942-1943, en effet, Pierre Brossolette (Brumaire) et Passy (Arquebuse) effectuèrent une mission clandestine en zone Nord d’importance stratégique Imaginer ainsi le chef des services secrets de la France combattante et son principal adjoint oeuvrer en France, au nez et à la barbe de l’occupant, au moment où, comme le rappelle Jean-Louis Crémieux-Brilhac, débutait « la grande offensive de la Gestapo » provoque l’étonnement. L’oeuvre accomplie fut à la hauteur du risque encouru. En deux mois et demi en effet, les deux hommes mirent en place les instances de coordination civile et militaire de la Résistance de la zone, ainsi que les premiers éléments de la future administration à la Libération. Ce faisant, ils contribuèrent nettement à l’entreprise de légitimation gaullienne face au général Giraud et aux Alliés, consistant à démontrer à ces derniers que la France combattante était soutenue par l’ensemble de la Résistance intérieure française. Mais la narration de la mission Arquebuse-Brumaire confronte le lecteur au principal défaut de l’ouvrage du colonel Passy. La qualité des résultats obtenus fut telle qu’il n’était point besoin de faire montre d’une mémoire sélective. Qu’il s’agisse du rôle de certains acteurs au long de l’hiver 1942-1943, en France ou à Londres, du contenu des instructions reçues, et des libertés finalement prises par rapport à des ordres de mission pourtant impératifs, Passy livre d’abord sa version des faits. Son récit en sort parfois fragilisé. Le souci d’exactitude historique contraint à étendre la critique à l’ensemble de l’ouvrage. L’histoire personnelle du colonel Passy en fit en effet un auteur bien particulier. Investi très jeune d’une responsabilité écrasante, il accomplit une oeuvre magistrale. Celle-ci déboucha pourtant sur un épilogue particulièrement malheureux : « l’affaire Passy » qui éclata peu après la Libération, et dont Jean-Louis Crémieux-Brilhac montre les ressorts et les développements. A l’automne 1946, à l’âge de trente-cinq ans, André Dewavrin, Français libre de la première heure, Compagnon de la Libération, ancien chef de la DGER, dut se retirer de la vie publique sous l’opprobre. Quelque mois seulement après avoir connu les honneurs du Capitole, le colonel Passy avait été précipité de la roche Tarpéienne… « Livre de combat » autant que mémoires, les souvenirs de Passy doivent par conséquent être abordés avec prudence. Le lecteur ne doit jamais oublier qu’il tient entre ses mains à la fois le récit fouillé d’un très important acteur de la Résistance française et la mise au point d’un homme finalement cloué au pilori. Placé au coeur des événements, décisions et missions, Passy eut beaucoup à connaître de la vie de la France libre puis combattante, et de ceux qui la firent. Ses mémoires regorgent donc très naturellement de portraits souvent sans concession, quelquefois inutilement négatifs sur les uns ou les autres, qu’ils s’appellent Jean Moulin, Emmanuel d’Astier de la Vigerie ou Pierre Fourcaud, Félix Gouin ou André Manuel, André Philip ou Christian Pineau, colonel Rémy ou Maurice Schumann. A l’inverse, Pierre Brossolette jouit d’un traitement particulièrement flatteur. Ami, mentor politique, principal adjoint puis compagnon de mission, Brossolette marqua à tout jamais le chef du BCRA. Son portrait apparaît excessivement louangeur : l’oeuvre remarquable en Résistance du chantre des « soutiers de la gloire » aurait suffi à établir sa postérité. Plus généralement, Passy montre les débats qui agitèrent la France libre puis combattante, ainsi que certaines des rudes querelles intestines qui, quelquefois, en découlèrent, et en donne une lecture souvent partiale. Il décrit les hésitations et approximations normales des services français libres, avant de livrer une vision parfois bien personnelle de certains événements ou processus, en particulier, on l’a dit, de la mission Arquebuse-Brumaire et de la constitution du CNR. Rédigés tôt après la Libération, au nombre des tout premiers mémoires d’acteurs de la Résistance française publiés, les souvenirs du colonel Passy donnèrent une foule d’informations précieuses pour la compréhension des années sombres. Simultanément, du fait de l’histoire personnelle de leur auteur et de l’inaccessibilité des archives, ils imposèrent une lecture quelquefois contestable des faits. Comme le souligne Jean-Louis Crémieux-Brilhac, ils éclairent « les étapes suivant lesquelles peut se construire la mémoire collective, mais aussi les cheminements au terme desquels s’accréditent les fausses légendes« . Aujourd’hui que les archives sont ouvertes et que les travaux scientifiques se sont multipliés, cet ouvrage important demeure une synthèse utile sur l’organisation du renseignement et de l’action en France à partir de Londres, entre 1940 et 1943. Il mérite d’être lu, étudié et disséqué par tous ceux que l’histoire des années sombres intéresse.
|